
Evolution stellaire. Tracé schématique
de l'évolution d'une étoile de la masse du Soleil sur le diagramme de
Hertzsprung-Russell |
Enchaînement des modifications que
connaît une étoile au cours de son existence, depuis sa naissance hors du
milieu interstellaire jusqu'à son extinction finale après combustion de son
carburant nucléaire. Les étoiles se forment en amas dans les nuages de gaz
et de poussière de la matière interstellaire. En se condensant et en
s'effondrant, la matière de la protoétoile provoque par libération d'énergie
gravitationnelle une élévation de température suffisante pour atteindre le
point de fusion de l'hydrogène en hélium. La durée de ce processus dépend
fortement de la masse de la protoétoile. Une étoile d'une masse égale à 10
fois celle du Soleil se forme en 300 000 ans, alors qu'il faut 30 millions
d'années pour que naisse une étoile de la masse du Soleil. La combustion de
l'hydrogène se poursuit jusqu'à son épuisement. Durant cette période,
l'étoile se trouve sur la séquence principale du diagramme de Hertzsprung-
Russell (voir article et tableau au dessus).
Sa durée est, elle aussi, inversement
proportionnelle à la masse de l'étoile. Ainsi, la durée de la séquence
principale du Soleil est de 10 milliards d'années (dont la moitié s'est déjà
écoulée), alors qu'elle n'est que de 500 millions pour une étoile trois fois
plus lourde. Lorsque la fusion de l'hydrogène s'arrête (par manque de
combustible), des ajustements se produisent pour compenser la perte de la
source d'énergie, qui modifient radicalement la structure de l'étoile. Le
noyau de l'étoile se contracte alors rapidement et libère une énergie
gravitationnelle qui chauffe les couches externes d'hydrogène jusqu'à
déclencher leur fusion. Celle-ci ne se déroule plus au sein du noyau, mais
dans une enveloppe située autour de lui. Le nouveau flux d'énergie produit
par cette fusion repousse progressivement vers la périphérie les couches
externes de l'étoile.
Durant leur expansion, les gaz se
refroidissent et forment ce que l'on nomme une géante rouge. L'effet combiné
de l'augmentation de la taille et de la diminution de la température permet
de maintenir une luminosité quasiment constante. Durant la combustion des
couches externes d'hydrogène, le noyau d'hélium se contracte à son tour
jusqu'à atteindre une température de 100 millions de degrés, soit le niveau
suffisant pour que sa fusion en carbone et en oxygène puisse commencer. La
nature et le contenu des phases postérieures à la combustion de l'hélium
dépendent de la masse de l'étoile. Au sein des étoiles les plus lourdes, la
contraction du noyau se reproduit après l'épuisement de chaque combustible
et permet d'enclencher la fusion d'un élément plus lourd. Ces processus
peuvent conduire en dernier lieu à une sìtuation où le noyau a été converti
en fer, alors que brûlent simultanément dans une série d'enveloppes
successives, du silicium, de l'oxygène, du carbone, de l'hydrogène et de
l'hélium.
 étoile et sa nébuleuse.
étoile et sa nébuleuse.
Lorsqu'une étoile a développé un noyau
de fer d'une masse équivalente à celle du Soleil, aucune réaction ne peut
plus se produire. Le noyau se contracte alors un nouvelle fois jusqu'à
imploser et à déclencher une explosion de supernova. Le noyau dépouillé qui
demeure devient alors une étoile à neutrons. Au sein d'étoiles de masse plus
faible telles que le Soleil, la température ne s'élève jamais suffisamment
pour déclencher les phases de combustion postérieures à celles de
l'hydrogène et de l'hélium au sein d'enveloppes concentriques. Des
instabilités se manifestent alors, qui conduisent les couches externes de
l'étoile à se séparer du noyau pour former une enveloppe de gaz en
expansion, appelée nébuleuse planétaire, qui se disperse progressivement
dans l'espace. Il est d'ailleurs probable, durant les dernières phases de
leur évolution notamment, qu'une grande partie de la masse des étoiles soit
perdue par l'effet du vent stellaire. Le noyau qui demeure alors se
refroidit et rétrécit jusqu'à avoir une taille voisine de de celle de la
Terre. La matière dégénère et forme alors une naine blanche, privée de
source interne d'énergie, mais qui rayonne encore et continue de se
refroidir progressivement.
L'évolution d'une étoile est souvent
illustrée par le dessin de sa trajectoire sur un diagramme de Hertzsprung-
Russell. Le schéma montre le tracé de l'évolution du Soleil. Pour les amas
d'étoiles, ce même diagramme montre l'effet de la masse sur le rythme de
l'évolution stellaire et peut être utilisé afin de déterminer leur âge. Le
schéma d'évolution décrit jusqu'ici ne concerne que des étoiles seules. Il
peut être totalement différent dans les cas de systèmes binaires ou
multiples si un transfert de masse se produit. |
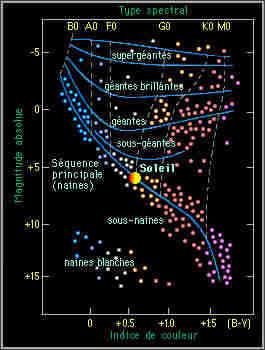
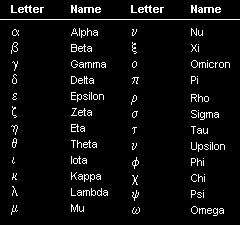 Tableau de l'alphabet grec
Tableau de l'alphabet grec

 étoile et sa nébuleuse.
étoile et sa nébuleuse.